Abonnez-vous!
Inscrivez votre courriel et recevez en avant-première les prochaines éditions!
Pourquoi il y a toujours une scène 

 dans les films de fin du monde?
dans les films de fin du monde?

C’est presque un cliché du cinéma catastrophe : alors que la fin du monde approche – un astéroïde fonce sur la Terre, un tsunami engloutit une ville, un volcan entre en éruption – deux personnages trouvent malgré tout le temps de s’embrasser à pleine bouche, voire plus si affinités.
Scènes de chaos d’un côté, pulsions vitales de l’autre : pourquoi ces instants d’intimité sont-ils aussi fréquents dans les films où tout devrait être consacré à la survie? Est-ce un reflet de la nature humaine ou une simple case à cocher pour réussir son blockbuster? Plongeons sans attendre dans une obsession hollywoodienne où extinction rime avec attraction.
Un baiser langoureux dans un film catastrophe : les exemples ne manquent pas. Je pense tout de suite à Armageddon, où Liv Tyler et Ben Affleck se séparent après avoir fait l’amour. Ou encore à Jack et Rose, qui consomment leur passion dans une voiture juste avant le naufrage du Titanic. Plus récemment, dans Don’t Look Up, plusieurs personnages réagissent à l’apocalypse par des pulsions de désir, les personnages interprétés par Jennifer Lawrence et Timothée Chalamet, par exemple. Ça, c’est sans parler de Volcano, 2012, Demolition Man, Deep Impact, Melancholia, The Day After Tomorrow et bien d’autres.
« Plus tu frôles la mort de près, plus la pulsion de vie est puissante. Le corps est en hyper stimulation », croit fermement Jean-Michel Berthiaume, docteur en sémiologie et spécialiste en culture populaire. La courbe narrative de plusieurs œuvres catastrophes s’apparenterait d’ailleurs en tout point à la courbe du plaisir sexuel masculin, affirme-t-il, s’appuyant sur plusieurs auteurs. « Pensez-y : ça monte, ça monte, ça monte. Il y a climax (on utilise d’ailleurs le même mot dans les deux cas), puis… tout redevient mou! Une fois que le danger est écarté, à quoi on sert, à part survivre? »
J’adore cette analogie! Que peut-on en conclure? « Qu’on construit nos histoires sur un pattern de pénis! Il serait temps qu’on commence à bâtir des histoires qui suivraient plutôt la courbe du plaisir offert par le clitoris », espère-t-il (et moi aussi!).
Dans les films catastrophes, on trouve typiquement deux représentations de la sexualité : les films dystopiques, avec des univers ultra contrôlés et oppressants, ont tendance à réprimer toute sexualité (Jean-Michel cite Sleeper, le film de Woody Allen qui représente la sexualité par une boule à l’extérieur des corps). « À l’inverse, on a les films postapocalyptiques, où les personnages se permettent d’être des êtres de chair. Ils cèdent à leurs pulsions, à leurs instincts primaux. Mad Max, les vieux et les récents, sont de bons exemples de ce retour à une sexualité moins propre, à une représentation des corps plus crue ».
Malgré tout, selon Jean-Michel, les productions hollywoodiennes restent très puritaines quand vient le temps de montrer la sexualité dans les films d’effondrement. « Les personnes s’embrassent mais on sait tous que ça cache une grosse baise sale », rigole-t-il. « Je pense à The Island, une dystopie où Ewan McGregor et Scarlett Johansson portent des one piece blancs moulants hyper révélateurs, exécutent des prouesses physiques et survivent dans les explosions. La sexualité est évoquée tout le long, on sent qu’ils attendent juste de baiser. Ils finissent par s’embrasser mais ne vont pas plus loin. »
« Les personnes s’embrassent mais on sait tous que ça cache une grosse baise sale »Jean-Michel Berthiaume, docteur en sémiologie et spécialiste en culture populaire
Speed, Le cinquième élément… Jean-Michel relève qu’il existe tout un corpus de films catastrophes dont le french langoureux final cache en fait une relation sexuelle, évidemment jamais montrée. « La sexualité, c’est l’incarnation de ce que l’on ne contrôle pas. Ce n’est pas étonnant que ce soit un levier si puissant dans les films où tout s’effondre. C’est une réponse instinctive à l’angoisse, un dernier élan de vie et de connexion avant le chaos. »
Oui mais… est-ce que tout cela relève juste de la fiction?
Voyons comment se portent notre libido et notre désir dans la vraie vie, alors que l’écoanxiété et les angoisses existentielles prennent de plus en plus de place.
« Même si je trouve follement romantique l’idée de faire l’amour sous des pluies acides… c’est plus facile à dire qu’à faire, car étrangement, face au danger, la libido a tendance à prendre le premier vol Easyjet vers le Groenland », affirmait l’autrice et chroniqueuse française Maïa Mazaurette en septembre 2023, sur France Inter. « C’est encore plus vrai dans le cas de la crise climatique, puisqu’elle vient se télescoper avec les raisons pour lesquelles on fait l’amour : si on couche pour se reproduire, on angoisse à cause de la surpopulation. Mais si on couche pour le plaisir, on angoisse à cause de notre culpabilité… vu qu’on est bien obligé de constater que la quête effrénée de plaisir, c’est justement ce qui nous a menés à la crise climatique. »
J’ai eu envie d’en discuter avec François Renaud, sexologue et psychothérapeute à Montréal.
« L’écoanxiété peut tout à fait avoir un impact négatif sur le désir sexuel, comme toute autre forme de stress. Quand on est anxieux, le système nerveux ne peut pas autant se laisser aller à l’excitation que quand on est relax », m’explique-t-il d’entrée de jeu. Toutefois, il est rare qu’une personne entre dans son bureau et dise explicitement que sa vie sexuelle est affectée par l’écoanxiété. Pourtant, consciemment ou non, ces sphères sont parfois intimement liées.
« Je pense à des personnes qui utilisent des contraceptifs hormonaux et qui sont très conscientes que les hormones en question sont évacuées par l’urine, finissent dans les océans, sont consommées par les espèces marines, etc. Certains vont même modifier leurs pratiques contraceptives afin de réduire leurs impacts, indique le sexologue. Je vois des gens qui se questionnent également sur l’utilisation des condoms, qui ne sont pas forcément durables. Ces considérations sur les impacts environnementaux de la sexualité et de la contraception peuvent créer une confusion suffisamment importante pour affecter l’envie de rapprochements. »
Selon les observations cliniques de François, dont la pratique inclut la thérapie de couple, l’écoanxiété peut devenir un problème concret qui divise les amoureux et les amoureuses et exercer un impact dévastateur sur le désir.
« Quand les partenaires n’ont pas le même degré d’engagement écologique, ça peut être un problème », confirme le spécialiste. « Prenons une personne qui vit une écoanxiété importante, voire envahissante, et dont le chum ou la blonde se sent peu concerné. Ça peut jouer sur son sentiment d’admiration envers lui ou elle et avoir des répercussions directes sur sa libido. »
Si le témoignage de François confirme ce qu’on peut lire par ailleurs sur les effets de l’anxiété sur la libido et la sexualité, une étude franco-chilienne citée par le CNRS en 2020 révèle que les catastrophes naturelles qui obsèdent les cinéastes d’Hollywood sont bel et bien des périodes de recrudescence de la reproduction. « Après un cataclysme, le sexe peut momentanément paraître comme une perte de temps et d’énergie. Pourtant, […] la reproduction sexuée peut s’avérer indispensable à plus long terme pour une meilleure résilience des populations », résume la revue. C’est-tu vrai, ça?
Pierre-Olivier Montiglio est professeur en écologie et en évolution du comportement au Département des sciences biologiques de l’UQAM. Il confirme qu’« il existe de nombreuses recherches sur la manière dont les espèces ont su s’adapter aux environnements imprévisibles, sur le plan de la reproduction, de génération en génération ».
Selon le spécialiste, on constate deux cas de figure liés à la régulation du stress.
« Certains oiseaux marins, comme la mouette tridactyle ou encore ceux qui vivent dans l’Arctique, ont une très petite fenêtre pour se reproduire et nicher au printemps, poursuit le biologiste. Il arrive qu’il y ait une tempête de neige, une température trop chaude ou toute autre variation. Dans des situations comme celles-là, ces animaux présentent une adaptation sur le plan physiologique, en sous-régulant leur réponse au stress. Il peut arriver qu’ils laissent tomber la reproduction cette année-là ou même, qu’ils abandonnent la couvée actuelle, quitte à perdre leurs poussins. »
Cette décision leur permet de survivre, de conserver leurs ressources et de se reproduire dans le futur.
D’autres espèces, pour leur part, ont plutôt adopté la stratégie inverse. « Certains insectes et de petits marsupiaux qui vivent en Australie, par exemple, vont se reproduire coûte que coûte, car ils savent que, sinon, ils ne survivront pas », illustre Pierre-Olivier. Il explique que ces espèces arrêtent complètement de répondre au stress, ne produisent plus de cortisol et vont se reproduire à tout prix, ce qui peut même les tuer.
Certains mâles vont se rendre malades à essayer de s’accoupler avec les femelles, ils perdent leur pelage, ils finissent par avoir une déficience immunitaire. En somme, toutes leurs dernières ressources, toutes leurs énergies vont être investies dans la reproduction. C’est ce qu’on appelle un investissement terminal.
« Certains mâles vont se rendre malades à essayer de s'accoupler. C'est ce qu'on appelle un investissement terminal. »Pierre-Olivier Montiglio, professeur en écologie et en évolution du comportement au Département des sciences biologiques de l’UQAM
On peut dire sans exagérer que ces chers mâles se tuent à la tâche... littéralement!
D’ailleurs, les animaux qui se reproduisent pour la dernière fois font une plus grande progéniture qu’à l’ordinaire, pointe le professeur. C’est un phénomène que l’on observe aussi chez les végétaux : « certaines plantes vont fournir énormément de graines juste avant de mourir ».
Puisque ces stratégies d’adaptation aux environnements imprévisibles sont le résultat d’une évolution sur plusieurs générations (voire des milliers de générations!), il n’est pas évident de transposer ces dynamiques aux changements climatiques et aux récentes catastrophes naturelles, qui surviennent en accéléré. Mais peut-on faire des suppositions concernant le comportement reproducteur des humains en situation de catastrophes? Au-delà de ce que nous montrent les films hollywoodiens, je veux dire?
Difficile à dire, selon Pierre-Olivier. « Dans un scénario où l’on s’adapterait à un monde, conscient d’avoir moins de ressources et qu’on va peut-être vivre moins longtemps, alors on se reproduirait intensément comme les petits marsupiaux. Par contre, si l’on est confronté à des environnements imprévisibles, on ressemblerait peut-être plus aux oiseaux marins. »
Comme s’interrogeait Shakespeare : quand tout s’effondre, to baise or not to baise?
Nommons l’éléphant dans la pièce : pour beaucoup bien des gens, les relations sexuelles ne servent pas qu’à se reproduire.
En ce sens, la sexualité, porteuse de plaisir et de joie, peut-elle sauver l’humanité? Devrait-on faire l’amour pour combattre l’écoanxiété?
« Ce n’est pas tant d’avoir plus de sexualité que d’avoir une meilleure sexualité », nuance le sexologue François Renaud. « On sait que les orgasmes ont plusieurs bienfaits. Ils procurent des sensations de détente et de bien-être. »
Et si l’antidote (momentané, du moins) à notre écoanxiété résidait justement dans la sexualité?
Suivez-moi bien : quand on a un orgasme, dans le cadre d’une relation sexuelle partagée ou grâce à la masturbation, le corps libère des hormones. Parmi elles, de la dopamine, de la sérotonine, des endorphines, qui agissent comme un antidépresseur naturel, mais surtout une bonne shot d’ocytocine, qui est reconnue pour réduire le taux de cortisol, l’hormone du stress. C’est une piste intéressante, non?
Et si l’on utilisait tout ce beau carburant généré par nos orgasmes pour lancer le moteur et se mettre en action, concrètement? Parce qu’à travers ses frenchs sous les volcans en éruption, les explosions et les pluies de météorites, finalement, n’est-ce pas justement ce regain de courage et de sens que nous montre (parfois) Hollywood?
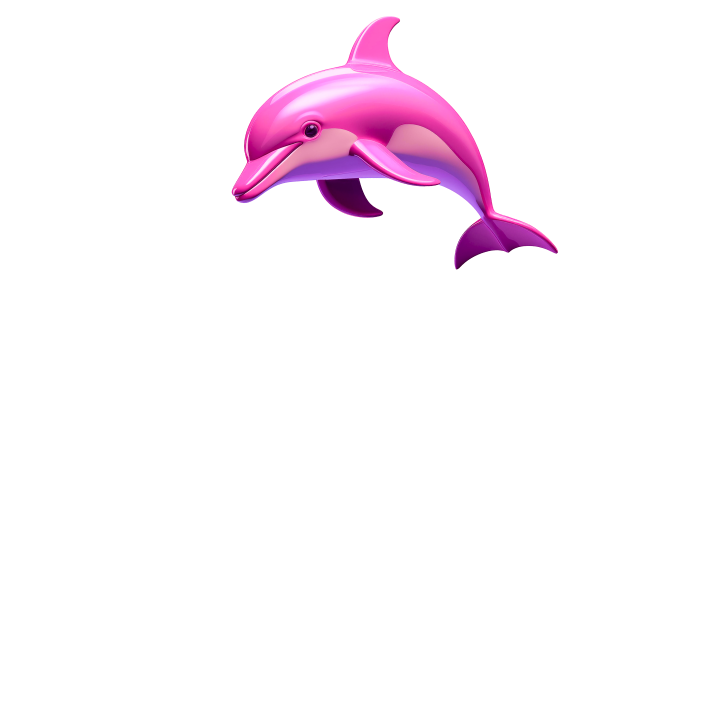
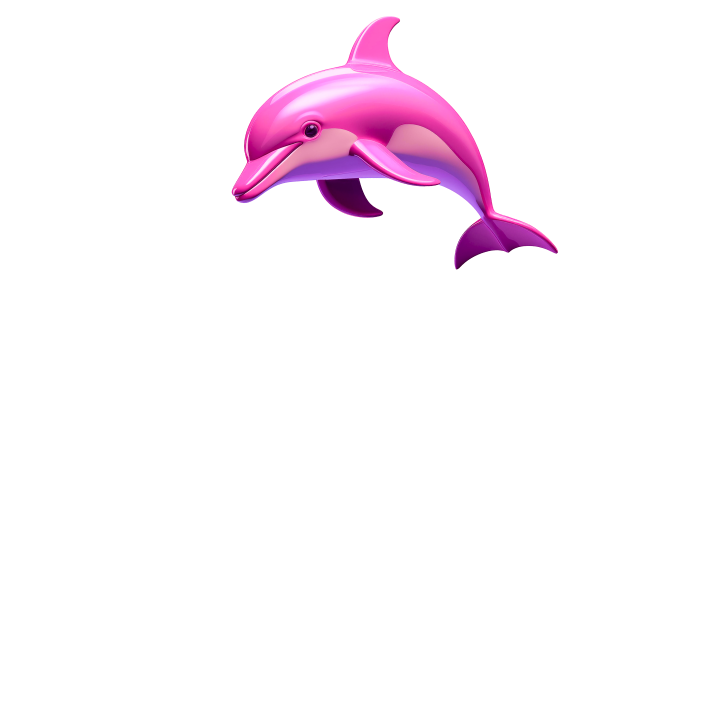
Conseil - Rebecca Dziedzic
Design - Julien Baveye
Développement - Vincent Rouleau